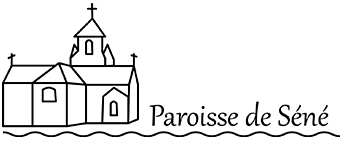L’Église face au problème des divorcés-remariés
Introduction
Dans un sondage IFOP, réalisé en 1978 pour l’hebdomadaire «La Vie», 62 % des catholiques pratiquants en France se déclaraient favorables au remariage des divorcés dans l’Église.
Un pourcentage plus important encore, 67 %, estimait qu’on devait les admettre aux sacrements de Réconciliation et de l’Eucharistie.
Ce sont là des chiffres, ils sont indicatifs. Mais cependant, la réalité pastorale a d’autres critères d’appréciation. Devant ce problème nouveau de société, qui atteint aujourd’hui un seuil critique, (environ 6000 divorces en Sarthe en 1987), l’Église, sans céder sur l’essentiel, se montre attentive aux situations de personnes, surtout quand celles-ci sont à jamais brisées dans leurs affections.
Jusqu’en 1965, on peut dire que la progression des divorces avait été contenue (Sauf peut-être dans la période qui avait suivi la guerre. On enregistrait 64 000 divorces en France, en 1946, contre 25 500 en 1942). Les années 70 voient au contraire un nouveau phénomène de société, confirmé par les lois libérales de 1971 aux Pays-Bas, de 1973 en Suède et de 1975 en France. Sans provoquer de bond en avant, la loi a entériné un état de fait, sauf peut-être au Danemark où l’on constate une recrudescence des divorces.
Une statistique récente, établie par la communauté dominicaine de Froidmont (Belgique), montre que plus de 60 % des divorces interviennent chez les couples, cinq ans après leur mariage. En France, le taux le plus élevé touche les tranches d’âge de 24 à 29 ans. Après 50 ans, les couples résistent mieux au phénomène, qui se produit surtout dans les couches sociales modestes et dans les classes moyennes.
Si un certain nombre de divorcés ne se pose aucune question religieuse avant d’entamer de nouvelles noces, ils sont nombreux ceux qui, tout en reconnaissant l’ambiguïté de leur situation, interrogent l’Église. «N’est-il pas possible de faire quelque chose ?» Question d’autant plus angoissée que 85 % des femmes de moins de 25 ans se remarient, et que 70 % des hommes et 60 % des femmes, sont remariés trois ans après leur divorce.
Il en est pour penser que l’attitude de l’Église à l’égard des divorcés remariés est trop intransigeante. Certains des divorcés-remariés ont le sentiment d’être rejetés par l’Église, même s’ils ne sont plus exclus comme hier. Mais, ne pouvant recevoir les sacrements, ils sont tentés d’abandonner toute pratique, et tout lien social avec leur communauté ecclésiale. Devant l’incertitude de faire aboutir un procès en nullité, ils se considèrent victimes d’ostracisme, surtout quand ils sont eux-mêmes innocents de la rupture d’un lien qu’ils auraient voulu voir durer.
Causes sociologiques des divorces
Depuis Vatican II, l’Église a donné une nouvelle lumière sur le mariage, en le définissant d’abord comme communauté de vie et d’amour. Or, c’est précisément sur ce point que les mariages sont aujourd’hui les plus menacés. Une importance plus grande est donnée à la relation affective, sans qu’interviennent souvent comme autrefois, des raisons de patrimoines qui sécurisaient l’union (spécialement dans le monde rural). Face à l’éclatement de la société traditionnelle en grande partie paysanne (JM Aubert), «les garde-fous de l’amour» sont moins nombreux. Économiquement plus libres et plus indépendants, les époux étendent considérablement le tissu de leurs relations humaines par leurs activités professionnelles et culturelles.
D’autre part, la réduction du nombre des enfants, qui autrefois entraînait une mission éducative plus longue, pousse les époux vers une solitude à deux prolongée. Cette situation engendre aussi des tensions plus fortes. Comparativement au siècle passé, on note aussi que la durée de la vie conjugale a considérablement augmenté. La moyenne d’âge plafonne pour les hommes à 73 ans, tandis que pour les femmes elle se situe aux alentours de 80 ans. Tout cela implique une série de problèmes nouveaux qui favorisent la rupture du couple, quand l’amour n’est plus au rendez-vous. Ajoutons l’influence du climat social qui favorise, par les médias, l’éclatement de l’institution. Les garanties qui entouraient hier le couple ont ainsi disparu, et la stabilité des unions dépend surtout aujourd’hui de la qualité des relations entre les époux.
Rester ensemble devient un idéal à réaliser, un engagement courageux face aux lois permissives de la société. Si, en régime de chrétienté, loi civile et loi canonique allaient de pair, imposer maintenant l’indissolubilité à un couple semble un défi à ceux qui n’ont pas la foi. C’est précisément ce défi que l’Église relève, parce qu’une conception toute matérielle du mariage est en dehors de la perspective judéo-chrétienne.
L’Écriture et le divorce
-
l’Ancien Testament :
La polygamie y était chose courante. L’exemple des patriarches, comme Abraham (avec Sarah et Agar, Gn 16), de Jacob (avec Léa et Rachel) (Gn29,25), de David, ou enfin de Salomon, témoigne de la liberté avec laquelle on pouvait changer d’épouse. On le faisait afin de préserver la race et la foi. Cependant, l’exemple du peuple élu est plus restrictif qu’il n’y paraît, à la différence du code d’Hammourabi par exemple, qui permet à l’homme ou à la femme de répudier son conjoint.
La loi mosaïque ne le permet qu’à l’homme. La réglementation du Deutéronome (chapitre 22) et du Lévitique (chapitre 21) montre toute l’évolution juridique dans un sens monogame. (L’adultère est généralement puni de mort). Écrit après le retour de l’exil, le récit de la Création (Gn 2,24), insiste sur l’unité du mariage aux origines, et fait dériver la polygamie de Cain. C’est là une prise de conscience que Jésus confirmera (Matthieu 13,6). Si les anciens pouvaient avoir plusieurs épouses et les répudier, ce n’était que concession, et cela en raison de la dureté des cœurs (Matthieu 19,8).
Le livre d’Osée montre jusqu’à quel point Dieu invite l’homme à un amour sans retour, malgré toutes les faiblesses de la partie infidèle et le dommage causé à l’innocent. -
les Évangiles :
C’est dans un monde où le divorce était couramment répandu, que Jésus révèle les exigences évangéliques du mariage. Il se positionne, non seulement face aux pratiques de l’Empire romain, mais bien plus, face au courant du monde juif, représenté par l’école de Hillel, qui admettait le divorce pour n’importe quel motif, et de l’autre, face à l’école de Shammaï, qui, plus fidèle à la pensée de Moïse, le réduisait aux cas d’inconduite et d’infidélité de la femme. Dans Matthieu 19,39, seul le cas d’impudicité (Bible de Crampon) ou de prostitution (Bible de Jérusalem) autorise à renvoyer sa femme, sans qu’il soit question de remariage possible, le texte ne le précise pas. Dans Marc 10, 2-12, plus ancien, le seul renvoi pour en épouser une autre est condamné. Jésus renvoie donc dos à dos les tenants des écoles sacerdotales juives.Les textes pauliniens préciseront, s’il le fallait, la parole évangélique dans (1Co 7,10-17). Paul présente l’interdiction du divorce comme un ordre du Seigneur : «Voici ce que je prescris, non pas moi, mais le Seigneur». En (Ep 5, 22-32), l’amour conjugal devient symbole de l’union qui existe entre le Christ et l’Église. On peut certes arguer du texte (Actes 15,19), pour dire que Jésus condamne en fait les unions illégales, c’est-à-dire contractées entre gens d’une même parenté. On se heurtera toujours cependant au texte de Matthieu 19,6 : «ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas».
L’Église face au divorce
Si la pratique de l’Église a connu quelques hésitations au cours des premiers siècles, et si elle a reconnu l’usage du droit coutumier en le réglementant, le principe de l’indissolubilité a toujours été affirmé. Il aura fallu cependant attendre le XIIe siècle pour classer le mariage parmi les sacrements de l’Église.
C’est à peu près partout que dans les trois premiers siècles, on affirme le principe de l’indissolubilité. Si certaines hésitations se manifestent, c’est en raison de l’incise «sauf en cas d’adultère». Le Pasteur d’Hermas, (précepte IV, 4-40) reprend Saint-Paul à la lettre. Le remariage des veufs chez Athénagore est méprisé. Il en parle en des termes d’adultère décent de condescendance. En 306, le concile d’Elvire se montre très strict. En 310 le Concile d’Arles convoqué par Constantin interdit le remariage, même lorsque les innocents sont jeunes. Au quatrième siècle, en Occident, se trouve pourtant une exception dans l’Ambrosiaster, l’auteur autorise le mari à renvoyer sa femme en cas d’adultère. Si Saint-Augustin affirme l’indissolubilité à cause du «bonum sacramenti» (Bono conjugali 400), il a cependant cette remarque «dans les personnes divorcées, il est véritablement difficile de savoir si celui à qui il est permis de renvoyer sa femme adultère est cependant tenu pour adultère s’il en épouse une autre, que à mon avis dans ce sens là, il pèche de manière digne du pardon» (De Fide et operibus VII,10 (Crouzel) L’Église primitive face au divorce).
Saint Grégoire le Grand établira le principe repris ensuite par l’ensemble de toute l’Église. «Un mariage consommé entre des chrétiens est indissoluble». On ne peut pas dire pour autant que l’Église de cette époque n’a pas connu quelques dérogations. Ainsi, les conciles de Vannes (461), et d’Agée(506) ont autorisé le mariage du mari abandonné mais non de l’épouse.
Au sixième siècle les pénitentiels connaîtront eux-mêmes quelques concessions, (le canon 11 de Théodore) admettra le remariage après une période de deux ans de pénitence, quand le mari est réduit en esclavage, ou lorsqu’il est fait prisonnier de guerre.
En Orient par contre, on a évolué très vite vers une pratique plus indulgente. Origène et Saint Basile manifestent une certaine condescendance pour la femme qui habite avec un homme répudié, que Saint Basile n’ose pas déclarer adultère. Sous l’influence de l’ambiance païenne et des lois civiles, on arrivera à assimiler l’adultère à une véritable mort et le concile de Quini Sexte en 692 permettra le remariage en certains cas. Soumise à l’empereur, l’Église se laisse alors influencer par le code Justinien, et elle admet certaines ruptures du lien (.DTC T : IX ,col 2327)
C’est au Moyen Âge, qu’Alexandre III et Innocent III fixeront pour l’Église romaine une pastorale pour le mariage des baptisés, énuméré en quatre points :
-
les fiançailles seront désormais nettement distinguées du mariage
-
le consentement conjugal rend inévitable le mariage sacramentel.
-
le mariage simplement consenti mais non consommé, bien que sacramentel, peut être dissout, au titre de la non consommation, par l’autorité pontificale.
-
Après consommation, le mariage entre baptisés est indissoluble, et cela de droit divin. (M Legrain les divorcés remariés)
Du XIe au XVe siècle :
Suite à l’affaiblissement du pouvoir royal, la législation matrimoniale passera aux mains de l’Église. La raison en vient de la décadence du pouvoir civil face au prestige épiscopal. Influencée par la scholastique, les Conciles de Lyon (1274) et de Florence (1439) affirmeront la sacramentalité du mariage. Mais la réaction protestante ne se fera pas attendre. Au XVIe siècle, les protestants ne voient dans le mariage qu’une intervention de l’Église. «Nulle part, dit Luther, il n’est écrit que celui qui prend femme recevra la grâce. On ne lit en aucun endroit de l’Écriture que le mariage ait été institué par Dieu. Légitimé dans certains cas, les protestants estiment que le divorce est non seulement permis, mais que la polygamie doit être admise. Luther, Melancton et Bucer l’autorisent en 1539. Calvin, par contre, réagit très fortement à cette proposition et la refuse (commentaire in Gn 16,1)
Si l’Église, au Concile de Trente, réagit contre les positions des protestants, elle se contente cependant de condamner ceux qui disent qu’elle se trompe lorsqu’elle enseigne l’indissolubilité (Dz 1807). Elle évite ainsi un malentendu avec les Églises d’Orient, et se garde de condamner leurs pratiques pastorales. L’Église romaine affirmera alors dans le décret Tametsi, que seuls sont désormais valides les mariages conclus selon la forme canonique. La situation en restera là jusqu’à la promulgation du code de droit canonique en 1917.
On admettra alors que pour une raison supérieure, le lien sacramentel puisse être rompu. (cas de la profession solennelle C 1119)
Depuis Vatican II, l’Église, semble-t-il, insiste moins sur l’aspect institutionnel du mariage. Vécu comme communauté de vie et d’amour, le mariage a pour vocation de réussir au-delà des échecs (M. Legrain). Le code de 1983 propose la pédagogie du pardon (C 1152) et l’autorité ecclésiastique est invitée à œuvrer à la réconciliation des époux. Séparés, les époux demeurent responsables de l’éducation comme de l’entretien de leurs enfants. On peut dire que l’actuelle législation ne semble pas se résigner à la séparation des conjoints. Cependant, comment ne pas voir aujourd’hui dans la jurisprudence de l’Église une grande souplesse malgré l’affirmation des principes.
Dans les années 80-85, c’est environ 80 000 causes qui, chaque année, sont examinés dans le monde, et les sentences rendues par les tribunaux ecclésiastiques, sont favorables dans le sens de la nullité, auprès de la moitié des cas (M. Legrain). Quoi qu’il en soit, il reste les autres, ceux qui se sachant inévitablement mariés, attendent force et réconfort de la communauté chrétienne. Rappelons ici la solution traditionnelle à leur égard :
Position traditionnelle de l’Église face aux divorcés
-
Malgré la rupture, le lien sacramentel persiste. Mgr Puech, ancien évêque de Carcassonne, nous dit «qu’en aucun cas, le divorce n’affecte la réalité du mariage : séparés, les époux restent unis devant Dieu, et ne peuvent contracter validement un nouveau mariage… Ce lien demeure jusqu’à la mort de l’un des conjoints. Dès lors, tout remariage constitue un adultère».
-
Les époux séparés ne peuvent se remarier. Si l’on considère le mariage comme une vocation particulière pour l’ensemble du peuple de Dieu, la solitude chaste à laquelle se voit condamné le conjoint innocent, n’est pas sans poser un véritable problème pastoral pour l’Église
-
les divorcés remariés ne peuvent approcher des sacrements pendant tout le temps qu’ils persévèrent dans leur union adultère.
-
les divorcés remariés ne sont pas pour autant excommuniés. Si on leur permet, et si on leur fait même un devoir de participer à la vie et aux prières de l’Église, ils ne peuvent en principe servir de parrain et marraine, ni occuper un poste à responsabilité dans la vie apostolique de l’Église (en catéchèse par exemple).
-
Depuis Vatican II, les divorcés remariés sont admis à la sépulture ecclésiastique.
-
Seulement dans deux cas précis, les divorcés remariés peuvent bénéficier des sacrements. D’une part s’ils promettent de vivre comme des frères et sœurs, d’autre part s’il y a réconciliation avec l’Église au moment de la mort.
Dans le premier cas, la communion doit être reçue dans la clandestinité pour éviter le scandale public, et parce que l’obligation de la séparation est impossible pour de graves motifs (par exemple éducation des enfants) (Familiaris consortium 22/11/81 Jean-Paul II) -
les divorcés remariés peuvent régulariser leur situation par la mort du premier conjoint : c’est là la position traditionnelle de l’Église, qui s’appuie sur les directives de la congrégation pour la doctrine de la foi en 1973, et qui est explicitée ensuite par le Cardinal Gag non en 1974 (alors Président de la Commission pontificale pour la famille). Jean-Palu ICI a rappelé les mêmes consignes, après le Synode sur la famille en 1980. Il établit toutefois une différence entre les divorcés qui se sont efforcés avec sincérité de sauver un premier mariage et qui ont été injustement abandonnés, et ceux qui, par une faute grave, on détruit un mariage canonique ment valable.
Il distingue aussi ceux qui ont contracté une seconde union en vue de l’éducation de leurs enfants, et qui ont parfois en conscience la certitude subjective que le mariage précédent n’avait jamais été valide, sans pouvoir pour autant le prouver canonique ment. Le pape invite alors les pasteurs à discerner les diverses situations qui sont toujours spécifiques.
L’attitude des Églises sœurs, et plus particulièrement celle de l’Église orthodoxe, se montre beaucoup plus large. Tout en rappelant le principe de l’indissolubilité, les orthodoxes font jouer le principe d’économie. C’est aux responsables de l’Église de trancher, et d’accorder des dispenses pour des motifs de compassion, ou pour aider un couple à retrouver une vie spirituelle. Cette mansuétude n’est pas sans poser d’énormes problèmes aux dires mêmes des théologiens. Les exceptions au principe de l’indissolubilité, ont vite tendance à se multiplier en mettant en jeu l’existence même du principe. (P. Elie Mélia)
Le pouvoir de dissolution dans l’Église
Dire que l’Église a une pastorale intransigeante, c’est oublier qu’elle s’accorde, dans certains cas, le pouvoir de dissoudre de véritables mariages. Elle prononce des annulations du lien même pour des mariages sacramentels.
C’est le cas, lorsque le Pape intervient dans des mariages non consommés (C 1140-1150). D’autre part, les mariages légitimes conclus entre deux non baptisés et les mariages «dispars» sont susceptibles d’être dissous.
Dans le premier cas, on trouve un exemple de rupture d’un mariage sacramentel non consommé, dès le Moyen Âge. Le pape Alexandre III (mort en 1381) prononce cette dissolution en faveur d’un Seigneur qui avait promis sous serment le mariage à une jeune fille, puis avait songé par la suite à la vie religieuse (M. Legrain Divorcés remariés p83))
En 1431, le Pape Martin V va même plus loin, il casse ce mariage, pour un homme marié qui n’avait pas eu de rapports conjugaux avec sa femme, alors que celle-ci était enceinte.
Pour les mariages légitimes, l’Église prononce la dissolution chaque fois que ceux-ci font obstacle à la foi catholique de l’un des conjoints qui vient à se convertir (cas du privilège Paulin), ou quand dans un mariage «dispars» (célébré avec dispense), la partie non baptisée met en danger la foi de l’autre, ou celle des enfants.
Avec l’avancée missionnaire de l’Église, et jusqu’en 1917, trois grandes constitutions : celle de Paul III, Pie V et de Grégoire XIII, ont régi la pastorale auprès des nouveaux convertis.
Depuis le CDC 2917, face à des situations matrimoniales inédites, où le non baptême et le divorce interviennent de plus en plus, les évêques ont pris l’habitude de recourir au privilège Pétrinien lorsque pour un mariage dispars, on a obtenu une dispense de disparités de culte. Cela se produit quand la partie non baptisée met en danger la foi de la partie baptisée et celle des enfants.
Peut-on imaginer que l’Église puisse aller plus loin ?
Des solutions nouvelles sont aujourd’hui proposées. Elles tiennent compte surtout de la relative facilité avec laquelle on s’est uni à l’Église, sous le seul prétexte que le Baptême confère le droit au sacrement. Les pasteurs sont souvent ulcérés, en assistant à des mariages qui manquent à l’évidence d’une authentique démarche spirituelle. Si les critères administratifs, dossiers avec déclaration d’intention où s’expriment la liberté, l’indissolubilité et la procréation, sont généralement acceptés, qui peut dire qu’un couple est prêt à s’engager dans l’amour, à l’image du Christ qui s’est livré pour son Église ! Dans notre diocèse, ils sont peu nombreux les couples, qui après avoir éclairé leur démarche dans la foi, sont disposés ensuite à vivre des exigences de cette même foi.
Face à la solution traditionnelle, certains s’étonnent de la facilité avec laquelle l’Église accepte le mariage de baptisés qui se sont unis d’abord civilement et qui ont ensuite divorcé. Pourquoi l’Église passe-t-elle si facilement sur un premier mariage civil !
Dans un autre domaine, on invoque aussi la pastorale à propos des prêtres ou des religieux qui ont obtenu leur réduction à l’état laïque, sous prétexte que le vœu du célibat n’était pas d’ordre sacramentel.
Face à la souffrance de ceux qui ont subi un grave préjudice «soyons sûrs, dit Mgr Puech, que l’Église ira jusqu’au seuil du possible !». Cependant, comment tenter une certaine libéralisation, sans risquer de mettre en danger le mariage lui-même et ceux qui y restent fidèles.
Sans condamner, l’Église veut pouvoir aider au mieux des situations souvent fort complexes, prendre tous les moyens possibles pour éclairer les couples désunis et les aider à avancer en vérité.
Chargé du dossier des divorcés remariés, le Cardinal Gagnon invite d’abord ces couples à utiliser pleinement les possibilités juridiques. «Il faut, dit-il, examiner s’il y a une possibilité quelconque de faire valoir une cause de nullité, ou d’obtenir une dispense pontificale. Tout catholique a le droit de bénéficier de toutes les possibilités que la loi lui ménage, et de trouver assistance à ce propos auprès des autorités compétentes». (Revue esprit et vie, 20/04/ 1978 P 243)
L’Église doit aussi recevoir les divorcés remariés comme ses membres et ses enfants. Le cardinal rappelle quelle doit être leur insertion dans la vie ecclésiale. D’abord dans la vie liturgique et la vie de prière, sous différentes formes. Ils peuvent prendre part à la liturgie pénitentielle non sacramentelle. Ensuite dans la vie apostolique, en participant aux différentes activités de l’Église. Mais ils ne peuvent remplir des fonctions de direction, ou des rôles qui leur feraient représenter l’Église. Dans la vie familiale, comme parents, ils sont tenus de former leurs enfants à la foi, à la vie chrétienne et à la prière.
C’est donc à la fois à une transformation des mentalités au sein des communautés chrétiennes, et à une reconnaissance des valeurs vécues dans la deuxième union auxquelles les chrétiens sont invités à réfléchir. «Il serait trop simple et trop injuste, dit la commission pour la famille, de séparer les couples en deux groupes : les bons qui sont restés ensemble, les mauvais qui se sont séparés pour une nouvelle union. La vie est sans doute plus complexe…. Nous avons toujours à nous rappeler qu’en un domaine ou un autre, nous sommes marqués par le péché !»
Une tentative d’accompagnement dans la prière au moment du remariage
Déjà, les divorcés remariés peuvent assister aux célébrations dominicales. Plus encore, l’Église leur en fait un devoir. Le père Lebourgeois, Évêque d’Autun, a cru bon cependant d’aller plus loin, en accompagnant les divorcés par une certaine démarche d’Église, au moment de leur nouvelle union. Dans une lettre aux prêtres de son diocèse (le 15/09/1976), il donne quelques directives pastorales en tentant d’éviter les équivoques. «Il arrive, dit-il, que l’échec soit consommé de manière irrémédiable… Toutefois, on pourra affirmer une attitude empreinte de compréhension et de miséricorde». Il édicte alors les règles suivantes :
-
on ne se dérobera pas au dialogue, chaque fois qu’il est demandé par des divorcés prêts à conclure une nouvelle union.
-
On aura vécu un entretien pastoral de même importance que celui qui est demandé pour la préparation d’un mariage.
-
Si le couple insiste pour demander un acte religieux, on pourra le faire, en l’aidant par un moment de prière dans les jours qui précèdent la célébration de la fête qui accompagne le mariage civil. Mais la prière devra garder un caractère discret et privé.
-
Enfin, à la rigueur, et pour les familles habituellement pratiquantes, on pourra dans les jours qui précèdent, célébrer l’Eucharistie à l’intention des familles.
-
Cet accompagnement ne devrait se faire qu’après avoir mis à la lumière, les motivations religieuses du couple. Le père Lebourgeois refusait donc de répondre aux critères de reconnaissance purement sociale. Il rappelait aussi les devoirs de justice qui incombent envers le conjoint abandonné et les enfants. À cela, il fallait exprimer le désir explicite de vivre l’Évangile (Pardon, ouverture, don de soi même aux enfants). Enfin, la célébration devait être discrète et privée, ayant lieu avant le mariage civil, pour éviter toute ambiguïté avec un véritable mariage religieux. Cette attitude fut reprise ensuite par les diocèses de Saint-Brieuc, de Sées, de Nantes, et de Luçon.
De fait, malgré toutes ces précautions, cet essai n’a pas reçu l’aval des autorités romaines. «Qu’on le veuille ou non, dit le Cardinal Gagnon, les assistants ou ceux qui ont entendu parler de cette cérémonie, acquièrent la conviction qu’il y a un second mariage. (Nihil est apertum quod non scietur). «On échappe difficilement aux apparences d’une concession dit le Cardinal, d’une résignation, ou d’un abandon de la fidélité due au Christ (esprit et vie78)».
Problèmes posés à la pastorale actuelle
Devant la situation des divorcés remariés, certains sont tentés d’apporter d’autres solutions, qui, elles, ne rentrent pas dans la pastorale actuelle de l’Église. Ils accusent les solutions traditionnelles évoquées plus haut d’être trop incohérentes, parce que peu réalistes. Si l’Église doit faire preuve de fidélité à sa mission, elle doit aussi se montrer signe d’amour et d’espérance dans un monde éclaté. Même si les évêques de France invitent les communautés chrétiennes à réintégrer les divorcés remariés, en créant autour d’eux un climat de fraternité et d’accueil, (document communautés chrétienne et divorcés remariés 1974), ils estiment qu’on n’en fait pas assez.
Les principaux motifs de leur contestation, visent surtout l’admission aux sacrements des divorcés remariés. Le remariage semble le seul péché irrémissible. Si on peut absoudre un criminel, pourquoi refuser le pardon à un divorcé remarié. Les enfants subissent eux-mêmes, un très grave préjudice en étant pénalisés par le mode de vie que l’on impose à leurs parents. Et cela peut avoir de graves conséquences dans leur cheminement spirituel et dans certains actes importants de leur vie de chrétien (le jour d’une première communion par exemple ou celui de leur profession de foi). Ils se sentent alors victimes d’injustice.
On conteste aussi les situations pastorales différentes, qui varient parfois d’un secteur à un autre, d’un diocèse à un autre, voire même d’un pays à un autre. Qu’en est-il alors de la communion dans l’Église ?
Pourquoi enfin tant de facilité à s’unir religieusement, et par la suite tant de rigueur en cas d’échec. N’est-ce pas pousser les jeunes à vivre plus longtemps en concubinage, et inviter les pasteurs à les détourner du mariage religieux, au moins dans certains cas flagrants ?
Conclusion
Ce sont là des questions importantes qui sont posées aux responsables de l’Église. Elles invitent la pastorale de certains diocèses à redéfinir son attitude, dans un monde qui est religieux mais qui n’est plus guidé par la lumière de l’Évangile.
En traitant du problème des divorcés remariés, ne sommes-nous pas amenés à penser qu’au-delà du mariage, c’est le problème de la pastorale du baptême qui est d’abord en jeu. (Peut-on affirmer aujourd’hui que la France est pays de mission ?) Car en fait, les directives qui émanent des autorités religieuses soulignent le radicalisme de l’Évangile, et ses directives s’adressent en premier à des chrétiens en voie de conversion. Elle renvoie à ce désir d’authenticité et de vérité qui poussait déjà Saint-Paul, lorsqu’il s’adressait aux chrétiens de Corinthe. «À ceux qui sont mariés, je prescris , non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Mais si elle s’en sépare, qu’elle ne se remarie pas ou qu’elle se réconcilie avec lui. Et que le mari ne renvoie pas sa femme» (1Co 7,10-11).
C’est à cette lumière que l’on peut mieux comprendre les mouvements spirituels qui accompagnent des couples en difficulté ou qui sont divorcés remariés. «Myriam Solitude», fondée par Daniel Bourgeois, ou Notre-Dame de l’Alliance en sont des exemples. Mais ce sont là des îlots isolés et ils constituent une élite.
Père Edmond Samson